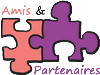On a pas vraiment acheté le ticket pour ce voyage-là, mais on le fait, avec ses détours, ses obstacles, et parfois une vue surprenante au bout du chemin. Apprendre à vouloir vivre", se révolter, faire quelque chose de l'expérience du cancer ou en faire le deuil. Le cancer bouleverse notre monde et notre manière de le voir. Dans ce très bel article, la journaliste Héloïse Lhérété, nous parle de ce voyage au bout de soi, un voyage non prémédité mais auquel aucun n'en réchappe. "Guérir n’est pas revenir… »
L'annonce d'un cancer marque le début d’une odyssée solitaire et radicale, d’où l’on n’est pas certain de revenir. Comment vit-on cette expérience ? Par quelles étapes passe-t-on ? Qu’y découvre-t-on de soi ?
Article de Héloïse Lhérété paru sur le site Sciences Humaine
Toute annonce d’une maladie grave est un coup de poing. Elle brutalise, révulse et sidère. Rien n’y prépare, rien n’en protège. Installés dans le confort de leur existence à durée indéterminée, les malades et leurs proches se voient soudain confrontés à l’impensé : la précarité de la vie. Une jeune femme atteinte d’un cancer évoque ce sentiment par une analogie redoutable : « Mon médecin me dit parfois, et il n’y a pas que lui, que de toute manière je peux me faire renverser par une voiture et mourir demain sur un trottoir. Ce qui est vrai, cela arrive. Le problème quand on a un cancer comme moi, c’est qu’on n’est plus sur le trottoir. Je suis au milieu de la route et je vois la voiture qui va me renverser me foncer dessus. Ça fait tout de même une différence(1). »
De ce point de vue, le cancer apparaît comme une épreuve singulière, radicale et solitaire. Il n’est pas seulement souffrance physique, fatigue, diminution, mutilation. Il transforme les rythmes du quotidien, déclenche l’engrenage des protocoles médicaux, oblige à changer ses habitudes, diminue l’activité sociale. Il est confrontation à soi et aux autres, dans un contexte où plane la menace de la mort : parce qu’une personne malade pense qu’elle risque de mourir, parce que le regard des autres le lui rappelle aussi, elle engage un voyage vers « le côté nocturne de la vie (2) ». Le sociologue Philippe Bataille, qui a réalisé une vaste enquête auprès de malades du cancer, l’écrit sans ambages : « La mort, sa mort, mais surtout la mort laissée à vivre aux autres, reste le problème central du ressenti psychologique et du vécu social de la maladie (3). » Quelle que soit l’issue, qui est heureusement de plus en plus souvent rémission ou guérison, des vérités et des enjeux de vie se révèlent au cours de cette expérience intérieure.
Le choc de l’annonce
Tout adulte qui a été confronté au cancer se souvient d’abord avec précision du contexte dans lequel il a reçu l’annonce du diagnostic. Pour beaucoup, cette annonce résonne comme une catastrophe. Étymologiquement, la catastrophe désigne « ce qui tourne sens dessus dessous ». C’est littéralement le cas. En un instant, l’illusion d’immortalité, sur laquelle tout bien-portant construit sa vie, s’évapore. Le psychologue Gustave-Nicolas Fisher note qu’il existe plusieurs façons d’y réagir : désarroi, colère ou dénégation. « Les premières réactions de révolte, refus ou déni sont autant d’expression symptomatique de non-acceptation, souligne-t-il. (…) En ce sens, la maladie teste d’abord la capacité intérieure à reconnaître la réalité (4). »
À cet égard, la maladie s’apparente à une épreuve de vérité, mais elle peut tourner en même temps à l’entreprise de dissimulation. Lors de son enquête, P. Bataille a constaté que de nombreux malades du cancer cachent leur maladie à leurs proches, quitte à mettre au point des ruses extrêmement sophistiquées. D’autres personnes, à l’inverse, éprouvent le besoin d’annoncer leur maladie au plus grand nombre. « J’ai un cancer du sein », annonce ainsi Cécile à une connaissance croisée dans la rue, comme si elle annonçait une nouvelle idylle amoureuse. La jeune femme, qui vient de recevoir ce diagnostic, semble rayonnante. Elle poursuit : « Avant, je ne me sentais pas bien, mais je ne savais pas pourquoi. Aujourd’hui, j’ai une vraie raison de me battre. Pour cette raison, je me sens plutôt plus heureuse… »
Pour les proches, ces deux types de réaction – dissimulation ou exaltation – restent souvent incompréhensibles. Ils se sentent exclus, à un moment où l’angoisse les fragilise aussi : « Je me suis chargé d’une sorte d’inquiétude existentielle, raconte Bruno, dont l’épouse se remet actuellement d’un cancer du sein. Mais je n’ai jamais parlé de ce que je ressentais : dès le départ, je me suis dit qu’il fallait que je remballe mes angoisses (…). Nous avons vécu une période conjugale un peu difficile. Puis j’ai pris conscience que je n’avais pas saisi tout le film. J’ai compris qu’elle s’est autoconcentrée sur elle-même, comme un sportif, presque comme un acteur qui va faire une performance et a besoin de se vider. Cela l’a sauvée ; mais c’est quelque chose qu’elle ne pouvait pas partager (5). »
Se battre, oui mais comment ?
Passé le choc de l’annonce, toute personne atteinte d’une maladie grave se trouve confronté à une nécessité vitale : il faut « se battre ». Le corps médical emploie très régulièrement un lexique guerrier, que le malade ne comprend pas toujours. Comment lutter quand on est épuisé par la maladie, assommé par les traitements, voire mutilé par la chirurgie ? Et contre quoi, contre qui, quand le mal est en soi ? « Sotte question, réplique le philosophe Marc Soriano, auteur d’un beau texte intimiste, Le Testamour, écrit sur son lit d’hôpital : « En fait tout se décide pour nous sans nous en nous dans cette jungle où s’entremêlent nos racines (6). » Fritz Zorn, jeune Suisse atteint d’un cancer et auteur d’un roman sur son expérience intitulé Mars, utilise pour sa part cette expression frappante : « Partout où j’ai mal, c’est là où je suis. »
À ce stade, il est courant qu’un malade tente de devenir expert de sa propre maladie. Il apprend le jargon médical, étudie les statistiques, recueille toutes les informations médicales possibles. Il reprend ainsi le contrôle, passant du statut de « patient » passif à celui de sujet actif. Mais la volonté de savoir se heurte au décalage entre la représentation médicale de la maladie et le vécu du malade. Cette dissonance apparaît invariablement dans les récits de malades : il arrive un moment où ils prennent conscience que la réalité vivante et douloureuse de la maladie déborde de part en part le discours froid et figé de la clinique (7).
La reconquête de soi doit donc passer par autre chose que la stricte anticipation médicale de l’évolution de la pathologie. Elle suppose de consentir à abandonner son corps aux équipes soignantes, le temps du soin. Le philosophe Jean-Luc Nancy, qui raconte dans L’Intrus son expérience d’une greffe du cœur, puis d’un lymphome, évoque une expérience de « dépossession ». Tout se passe comme s’il s’était trouvé exproprié de lui-même à mesure que son corps devenait objet d’analyse, d’auscultation, de palpation, d’expérimentation, de normalisation. Le geste médical tend en prime à morceler ce corps, réduisant l’individu à la défaillance de l’un de ses organes. « Comment va cette hanche, ce cœur, ce sein ? », demande le soignant au malade qui aspire, de son côté, à être perçu comme une personne dans sa globalité. « On sort égaré de l’aventure, à la fois aiguisé et épuisé, dénudé et suréquipé, intrus dans le monde aussi bien qu’en soi-même », témoigne J.-L. Nancy.
Après la peur et la souffrance physique, vient le temps d’une douleur moins aiguë mais plus profonde qui touche l’individu corps et âme. Certains sociologues, comme David Le Breton, perçoivent dans ce moment « l’ouverture d’un espace sacré », qui force à regarder le monde de façon plus métaphysique. La psychologie de la santé insiste plutôt sur l’émergence de « leviers de survie ». Au pied du mur, il s’agit ni plus ni moins que de trouver des raisons de vivre, d’« apprendre à vouloir vivre (8) ». Le lien avec ses enfants ou avec un être aimé constitue souvent un puissant ressort. « Je me bats pour mon fils, ma fille », expriment fréquemment les malades du cancer rencontrés par P. Bataille. La colère contre la maladie, qui se répercute parfois sur les proches et les soignants, peut également agir comme une énergie régénératrice.
Quelles que soient les forces rassemblées, elles travaillent à une métamorphose de soi. Dans le creuset de la maladie apparaissent des facettes de soi insoupçonnées. Un malade peut se découvrir extrêmement déterminé, quand bien même il ne se serait jamais perçu comme une personnalité combative. Il peut révéler un humour corrosif, en plein drame de son histoire, quand il aurait toujours passé pour un individu austère.
Guérir de la guérison
Que reste-t-il de cette expérience quand la menace vitale s’éloigne et quand se profile l’horizon d’un « retour à la vie normale » ? La philosophie, depuis Sénèque, insiste sur ce paradoxe : la maladie a pour vertu de réveiller l’existence. Souffrir, c’est ressentir. La vie, qui se déroule comme une évidence quand tout va bien, fait l’objet de questionnements intenses quand le corps se dérobe. La sensibilité explose. Des disputes violentes et des rencontres magnifiques aboutissent à une recomposition du cercle amical. L’état d’esprit à l’égard de l’avenir n’est plus le même : beaucoup d’anciens malades, une fois rétablis, disent vouloir « privilégier l’essentiel », parfois se réaliser dans un tout autre métier, ou vivre dans un tout autre environnement, que ceux d’avant la maladie. Le corps, lui aussi, a changé : les muscles ont fondu ou le corps a gonflé, le visage s’est transformé, un sein ou une prostate ont été sacrifiés sur l’autel de la guérison. L’image de soi s’est brouillée. Pour toutes ces raisons, la guérison biologique ne se résume jamais à un simple retour à la « vie d’avant ». « Guérir n’est pas revenir… », note Georges Canguilhem (9).
L’une des attitudes les plus communes consiste en une « spiritualisation de la maladie » (Friedrich Nietzsche). Beaucoup d’anciens malades cherchent ainsi à tirer de la maladie une leçon de vie. Forts de leur expérience de la faiblesse, ils déclarent avoir accès à une connaissance plus approfondie de soi, des autres et du monde. L’un des exemples les plus célèbres est celui de Nietzsche, qui affirme être devenu philosophe grâce à la maladie, et même avoir bâti toute sa pensée sur la « volonté de vivre » ressentie au plus près de la mort. Il va jusqu’à expliquer par cette épreuve « pourquoi (il) écri(t) de si bons livres » : « La maladie me dégagea lentement de mon milieu ; elle m’épargna toute rupture, toute démarche violente et scabreuse. (…) Elle me permit, elle m’ordonna de me livrer à l’oubli ; elle me fit hommage de l’obligation de rester coucher, de rester oisif, d’attendre, de prendre patience… C’est là précisément ce qui s’appelle penser (Ecce Homo, 1888). » Son expérience rejoint celle que vivent aujourd’hui de nombreux malades du cancer : il apparaît vital de réinscrire la maladie dans la cohérence d’une existence personnelle, d’« en faire quelque chose » pour la renaissance à venir. Cela peut passer par l’écriture, l’art, la spiritualité, un engagement associatif…
Une autre attitude, qui succède parfois à la précédente, consiste à chercher les clés pour guérir de la guérison. Il ne s’agit plus de « faire quelque chose » de sa maladie, mais au contraire d’en faire le deuil. Non pas rayer la maladie de son histoire, mais la restituer à sa juste place : une parenthèse douloureuse, subie et non voulue, qui doit se refermer. Dans les hôpitaux, des services psychologiques peuvent accompagner les anciens patients. Roland Gori et Marie-José Del Vongo, chercheurs en psychopathologie, expliquent ainsi l’enjeu de ce travail sur soi : « Guérir, ce n’est pas seulement oublier une maladie que la médecine a traitée avec succès, guérir c’est aussi oublier le savoir qu’elle procure sur la cause et l’heure de sa mort. C’est, en somme, oublier la mort pour mieux retrouver le temps dans une durée où l’on ne sait pas quand et de quoi on va mourir. C’est (…) rouvrir de nouveau l’énigme de son terme, de son échéance, que la maladie avait prématurément résolue (10). »
À ce stade, il ne s’agit pas tant de guérir que de vivre, ni tant de « privilégier l’essentiel » que de renouer avec l’accessoire, petits conflits et jolies saveurs qui tissent la trame du quotidien. Reconnaître, peut-être plus consciemment que les autres, l’incertitude de l’avenir. Savoir qu’on peut « mourir demain sur un trottoir », mourir dans deux ans d’une rechute, ou alors mourir centenaire, après une vie bien remplie. S’ouvrir à cette part d’inconnu, c’est authentiquement avoir surmonté l’épreuve de la maladie.
NOTES :
(1) Témoignage recueilli par Philippe Bataille, « Le travail de conscientisation du sujet : les malades du cancer et la mort », in Vincent Caradec et Danilo Martuccelli, Matériaux pour une sociologie de l’individu, Presses universitaire du Septentrion, 2004.
(2) Susan Sontag, La Maladie comme métaphore, Seuil, 1979.
(3) Ibid.
(4) Gustave-Nicolas Fisher, L’Expérience du malade. L’épreuve intime, Dunod, 2008.
(5) Témoignage de Bruno, « Couple : la traversée du cancer »
(6) Isabelle, Véronique et Marc Soriano, Le Testamour ou Remèdes à la mélancolie, 1982, Flammarion, 1992.
(7) Lire notamment Claire Marin, Hors de moi, Allia, 2008.
(8) Gustave-Nicolas Fisher, op. cit.
(9) Georges Canguilhem, Écrits sur la médecine, Seuil, 2002.
(10) Roland Gori et Marie-José Del Vongo, La Santé totalitaire. Essai sur la médicalisation de l’existence, rééd. Flammarion, 2005.