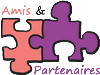Dans mes ateliers collectifs "Préparer le retour au travail après un cancer à travers le patient empowerment", j'éprouve toujours beaucoup de joie à voir combien les participantes s'entraident naturellement malgré les profils variés : technicienne de surface, manager dans le secteur bancaire, responsable des ressources humaines, enseignantes... Il n'y a jamais de condescendance, juste de l'empathie et le désir d'aider l'autre, malgré les difficultés traversées personnellement. Dans cet article de Paris Match, le psychologue Jacques Lecomte l'affirme, les humains sont prédisposés à la coopération : "Nous pouvons être des pollinisateurs de bonté".
Un article de Michel Bouffioux pour Paris Match
L’esprit de Noël invite à la bienveillance, à la compassion et au partage… Ça tombe bien : la science prouve que les humains sont naturellement prédisposés à la bonté et à la coopération. Rencontre avec Jacques Lecomte, l’un des principaux experts francophones de la psychologie positive.
Paris Match. Dans une société qui cultive beaucoup l’individualisme et la compétition, n’est-il pas compliqué de porter le message, comme vous le faites dans vos livres et conférences, que les humains sont prédisposés à la bonté et à la coopération ? Ne vous taxe-t-on pas parfois de « doux rêveur » alors même que vous fondez votre argumentation sur les dernières connaissances scientifiques ?
Jacques Lecomte. Mais bien entendu ! J’entends fréquemment cette même objection quand je parle de la bonté humaine. Dans les salles où je donne des conférences, dans les dîners et les réunions de famille, il se trouve souvent quelqu’un pour me dire : « Mais vous êtes un bisounours ! Revenez sur Terre, les gens sont bien plus égoïstes que vous ne le pensez. » Alors, systématiquement, je réplique : « Mais les gens, c’est vous aussi. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes fondamentalement égoïste, que vous ne vous préoccupez que de vous-même, que votre intérêt personnel est la boussole de toutes les actions de votre existence ? » À ce moment, c’est assez systématique aussi, mon aimable contradicteur est embarrassé et il rétorque : « Oui, enfin, ce n’est pas tout à fait ce que je voulais dire. Vous, moi, mes proches, ce n’est pas pareil. Mais le monde, vous savez… » Voyez-vous, il n’y a rien de très extraordinaire dans cette anecdote : elle illustre un défaut assez commun, celui de se croire moralement plus vertueux que la moyenne des gens. C’est ce que les psychologues dénomment le « biais de positivité ».
Votre propos invite à objectiver le regard que l’on porte sur soi mais, surtout, ne dit-il pas beaucoup d’une vision pessimiste de l’humanité largement partagée dans notre société ?
C’est là effectivement que je voulais en venir. Notre culture est imprégnée de l’idée qu’on ne peut trop miser sur la bonté humaine parce que cela participerait d’une forme de naïveté, laquelle ferait fi de la nature profondément égoïste et violente de notre espèce. Cette croyance populaire — j’insiste sur le terme « croyance », parce qu’il ne s’agit de rien d’autre que cela — a pour corollaire de considérer le cynisme comme une forme d’intelligence ou de réalisme, voire d’assimiler la méfiance dans les rapports humains à une forme de sagesse. Cependant, cette vision pessimiste de la nature humaine s’appuie sur des références fragiles, pour ne pas dire inconsistantes. Un exemple. Vous connaissez certainement cette phrase si rabâchée qu’elle sonne comme une vérité : « L’homme est un loup pour l’homme. » S’agit-il là de la conclusion d’une étude anthropologique ou d’une enquête sociologique ? En est-on arrivé à une conclusion aussi définitive sur la nature humaine au bout d’innombrables expériences scientifiques standardisées ? Nullement. Cette sentence n’est en fait qu’une opinion. Celle d’un dramaturge romain, Plaute en l’occurrence, un homme dont on sait peu de chose et qui, un jour, a fait dire cela à l’un de ses personnages de fiction. Se forger une vision des rapports humains avec un tel matériel, ce n’est évidemment pas très sérieux.
Sans doute, mais nombre de penseurs et « savants », pas les moins renommés, n’ont-ils pas exprimé un point de vue tout aussi pessimiste sur l’être humain ?
Certes, oui ! Impossible de les citer tous. Prenons par exemple le philosophe anglais Thomas Hobbes. Au XVIIe siècle, il considérait que les humains sont animés par « un désir perpétuel et sans trêve d’acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu’à la mort ». Plus près de notre époque, Freud a porté un regard tout aussi négatif sur notre nature profonde, estimant qu’elle ne serait conditionnée que par la recherche de satisfaction de pulsions individuelles. Exit l’empathie désintéressée ! Dans une correspondance, il exprima le fond de sa pensée : « Je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du mal, mais, en moyenne, je n’ai découvert que fort peu de “bien” chez les hommes. D’après ce que j’en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille. » Aussi pensait-il que « l’agressivité est un trait indestructible de l’homme ». Tout cela a été affirmé avec beaucoup de conviction, tout cela a été cru et est devenu, en quelque sorte, parole d’évangile. Pourtant ce « savoir » s’est construit sans que ne soient menées de multiples enquêtes de terrain sur les interactions entre les humains, sur leur inclinaison à la bienveillance et à la coopération en diverses situations.
Konrad Lorenz, le fondateur de l’éthologie, n’a-t-il pas, lui aussi, conclu que les humains étaient foncièrement agressifs ?
Oui, et il l’exprima avec une certaine autorité, notamment dans son livre « L’Agression ». Une vérité scientifique ? Pas du tout. Il s’agit de déductions induites par l’observation d’autres espèces animales, telles que les loups. À vrai dire, quand on passe en revue l’histoire du discours pessimiste sur la nature humaine, on se rend compte qu’il a été un fil conducteur dans de nombreuses disciplines. Aussi l’idéologie de l’humain égoïste est-elle le fondement de la théorie économique néoclassique qui a créé la figure d’un « Homo economicus » rationnel et maximisateur, incapable de désintéressement. D’une certaine manière, c’est décrire les êtres humains sous les traits de psychopathes qui, dans tous les actes de leur vie, ne viseraient que leur seul profit personnel.
Bien entendu : les aspirations à la coopération sont dévalorisées. L’idée qu’il y a compétition permanente entre les individus est privilégiée. La méfiance est de mise et la bonté devient de la naïveté. Que le plus fort gagne ! À force de marteler ce discours, il est devenu une croyance partagée laissant le champ libre aux prophéties autoréalisatrices : si vous êtes convaincus que l’homme est un loup pour l’homme qui n’hésitera jamais à jouer de mauvais tours pour sauvegarder ses propres intérêts, vous allez adopter une certaine attitude. Baignant dans cette même culture, ceux avec lesquels vous interagissez vont évidemment le percevoir et être confortés dans le même raisonnement que vous. C’est ainsi qu’une vision fausse des interactions sociales peut se trouver confirmée. C’est un cercle vicieux.
Que nous dit l’anthropologie de la bonté humaine ?
Il y a eu des ouvrages pour nous présenter comme des êtres violents qui descendent de grand singes tueurs programmés pour se battre sans cesse pour leur survie. Il y a eu des théories sur les peuples premiers qui auraient été encore plus violents que nous. Mais là encore, les recherches actuelles montrent qu’il s’agissait de manières de voir partielles, imprégnées des présupposés négatifs sur la nature humaine. Les grands singes sont essentiellement pacifiques. Par ailleurs, les peuples de chasseurs-cueilleurs sont plutôt coopératifs. En somme, l’humain d’hier et celui d’aujourd’hui se ressemblent : nous ne sommes ni brutes, ni agneaux.
Ne devons-nous pas questionner nos croyances en observant d’autres cultures ?
Bien évidemment. Cela permet de comprendre que la vision pessimiste qui a dominé notre idéologie n’est pas universelle : d’autres peuples sont eux imprégnés de l’idée que l’être humain est avant tout un être social, pacifique et coopératif. Voyez l’histoire des Iroquois, par exemple. Bien avant l’arrivée des Européens et pendant plus de trois siècles, ces autochtones d’Amérique qui croyaient à la fraternité ont mis en œuvre une première version des Nations unies, garante d’une loi de la paix et rassemblant six nations. Cette Ligue des Iroquois a mis fin aux guerres entre ses membres. Aussi, dans le sud de l’Afrique, un proverbe dit : « Umuntu ngumuntu ngabantu », ce qui signifie : « Un être humain est un être humain au travers des autres êtres humains. » Dans cette partie du monde, on utilise beaucoup le mot « ubuntu » qui décrit le sentiment d’une commune humanité, de la générosité et de la grandeur d’âme. Il s’avère que l’ubuntu a été au cœur de la démarche de réconciliation mise en œuvre par Nelson Mandela après le temps de l’apartheid. Ce grand homme, malgré toutes les souffrances endurées, pensait que « la bonté de l’homme est une flamme qu’on peut cacher, mais qu’on ne peut jamais éteindre ».
Mais vous parlez de l’apartheid, et on pense aussi aux guerres, aux génocides, aux crimes… Au regard de ces horreurs, ne semble-il pas contre-intuitif de donner crédit à la bonté humaine ?
Mon propos n’est pas de nier l’existence du mal, d’être aveugle au fait que l’être humain peut se tourner vers la violence et l’injustice à cause d’un manque existentiel ou d’un formatage idéologique. Mais il ne faut pas réduire notre vision du monde à l’observation de ce qui est sombre, à ce qu’on qualifie d’ailleurs justement d’« inhumain ». La guerre n’est pas présente partout sur Terre et la majorité des peuples aspirent à vivre pacifiquement. Dans les écoles militaires, on sait fort bien que les soldats ne sont pas assoiffés de sang : ils doivent être formés à tirer sur des cibles mouvantes parce que, sans cela, en situation de conflit, la tendance naturelle de la majorité d’entre eux serait de ne pas appuyer sur la détente. Les criminels ? Ils ne sont pas majoritaires dans les sociétés et sans doute ne parle-t-on pas assez de ceux qui finissent par s’inscrire dans un processus de « désistance », c’est-à-dire de reconstruction positive. Aussi ne percevons-nous pas assez que dans les moments les plus horribles de l’histoire de l’humanité, la bonté désintéressée ne disparaît pas. Pensons à ces héros qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre. Une enquête menée après le conflit a mis en évidence que 96 % des personnes sollicitées pour aider des Juifs avaient répondu positivement. Songeons à ce qu’écrivit Primo Levi à propos d’un homme qui lui vint en aide pendant plusieurs mois en lui donnant des petits suppléments de nourriture alors qu’il était détenu dans un camp auxiliaire d’Auschwitz : « Il ne demanda rien et n’accepta rien en échange, parce qu’il était bon et simple, et ne pensait pas que faire le bien dût rapporter quelque chose.»
La science nous aide-t-elle à mieux cerner la nature de l’être humain ?
Oui. Depuis une trentaine d’années, nous vivons une révolution scientifique. Dans des domaines très divers — la neurobiologie, la sociologie, la psychologie, l’anthropologie, etc. —, la science a mis en lumière un être humain prédisposé à l’altruisme, bien différent donc de cet égoïste agressif dont nous ont parlé tant d’experts autoproclamés dans le passé. En synthèse, des « opinions » d’antan sont désormais contredites par un véritable savoir construit dans le respect des standards de la science moderne.
Il n’en reste pas moins que l’idéologie de l’homme égoïste a la vie dure ?
Elle est omniprésente. Pensez aux films catastrophe qu’on nous donne régulièrement à voir. « La Tour infernale » est un modèle du genre : on nous montre des humains qui paniquent, des mouvements de foule incontrôlés, des individus qui ne pensent qu’à sauver leur peau au détriment de celle des autres. Mais quand on documente scientifiquement les vraies catastrophes, comme l’ont fait des sociologues, les victimes apparaissent très majoritairement sous un autre visage : celui de la lucidité, de la détermination, de l’entraide. Elles fonctionnent sur le mode du « nous » plutôt que du « je ». Les gens sont alors prêts à sacrifier leur vie pour aider les autres.
Quel est-il, alors, cet humain dont nous parle la science ?
Il ne s’agit évidemment pas d’affirmer que « les humains sont bons par nature, fin du débat ». De manière plus nuancée, la science nous parle d’un terreau fertile. Elle invite à prendre conscience que nous appartenons à une espèce dont l’immense majorité des individus a une propension à la bonté, car cette prédisposition biologique a été démontrée. Entre autres exemples, on peut évoquer les expériences réalisées par des chercheurs de l’Institut Max Planck, à Leipzig. Il en ressort que l’altruisme est naturellement présent chez une majorité de bébés dès l’âge de 14 mois, c’est-à-dire chez des enfants qui viennent seulement d’apprendre à marcher.
Comment se déroule cette expérience ?
Un bout de chou est emmené dans une pièce qu’il ne connaît pas en compagnie de sa maman. Cette dernière est là seulement pour le rassurer, pas pour guider ses actions par la parole ou le regard. Tout à coup, un jeune homme entre dans le local, les bras chargés de cartons. Il se dirige vers un placard et puis il s’arrête net, manifestant de l’embarras : comment ouvrir la porte avec tous ces paquets qui l’encombrent ? La majorité des bébés décodent l’événement et prennent une décision : se diriger vers le placard pour en ouvrir la porte. Pour poser cet acte, il y a deux prérequis. Le premier est d’ordre cognitif : l’enfant doit comprendre que l’homme est en difficulté. Le second, c’est qu’il puisse éprouver de l’empathie, le désir d’aider un inconnu sans qu’aucune récompense ne lui soit promise. Notez que cette expérience a connu des variantes particulièrement éclairantes. Dans l’une d’elles, des jouets sont disposés autour de l’enfant et on attend qu’il s’amuse bien avant de faire entrer l’inconnu. Cela n’empêche pas une majorité de bébés à interrompre le plaisir du jeu pour porter aide. Et si l’on place des blocs de mousse dans la pièce pour rendre compliqué le passage vers le placard, beaucoup d’enfants sortent résolument de leur zone de confort pour aider l’inconnu. Ces bébés ne nous donnent-ils pas une magnifique leçon d’humanisme ?
La neurobiologie n’a-elle pas aussi apporté quelques enseignements ?
Oui, elle a établi que notre cerveau est prédisposé à l’amour, à la coopération, à l’empathie ou encore au sentiment de justice. Par des mécanismes qui semblent innés, toutes les émotions liées aux interactions sociales positives nourrissent des zones cérébrales dites de récompense ou de la satisfaction. En résumé, quand on manifeste de la bonté envers les autres, notre cerveau nous en remercie. Ces états neurologiques sont mesurables, ce qui permet de préciser que si la coopération stimule des zones de récompense, la compétition ne le fait pas. Mieux encore, on sait depuis la découverte des neurones miroirs en 1990 que des zones cérébrales sont aussi activées lorsque l’on observe une situation vécue par une autre personne, et que ce système de récompense fonctionne même quand on imagine ce que d’autres vivent sans en être le témoin direct. À distance, des personnes peuvent donc ressentir des stimulations cérébrales semblables, comme si leurs cerveaux communiquaient. Un spécialiste, le professeur Giacomo Rizzolatti, a eu cette belle phrase : « Les neurones miroirs nous montrent combien les liens qui nous unissent aux autres sont profondément enracinés en nous, et donc à quel point il peut être bizarre de concevoir un moi sans un nous. »
Reste qu’une prédisposition à la bonté ne suffit évidemment pas à déterminer un individu. Ne parlera-t-on pas plutôt dès lors d’un potentiel à cultiver ?
C’est exactement cela. La culture, l’éducation, des expériences vécues peuvent être des engrais formidablement efficaces ou à l’inverse, elles peuvent être délétères et limiter notre empathie. Ce qui est rassurant, c’est qu’il y a une certaine plasticité. On peut cultiver sa bienveillance, s’éveiller toujours plus aux autres. Au-delà des questions de l’acquis et de l’inné intervient donc un troisième terme : le libre arbitre, la responsabilité individuelle. En somme, le choix conscient d’essayer d’être bon avec les autres. Un conte attribué aux autochtones d’Amérique du Nord illustre bien cette responsabilité personnelle. Un grand-père explique à son petit-fils qu’en chacun de nous coexistent deux loups : l’un est le loup de la peur, de la haine et de l’égoïsme ; l’autre est le loup de la confiance, de l’amour et de la bonté. Le petit garçon demande alors à son aïeul : « Quel est le loup qui gagne, finalement ? » Ce à quoi le vieux sage répond : « Celui que tu nourris le plus. »
La bonté est-elle contagieuse ?
Elle l’est ! La bonté se pollinise. Une histoire étonnante mais tout à fait véridique s’est passée, il y a quelques années, dans un restaurant de Philadelphie, aux États-Unis. Deux amis venaient de finir leur repas et ils demandèrent la note au serveur. Celui-ci leur répondit que leur addition avait déjà été payée par un couple qui venait tout juste de quitter l’établissement, sans laisser de nom ou de message. Touché cette générosité désintéressée, les deux amis décidèrent d’honorer la note d’une autre table. Et c’est ainsi que démarra une épidémie de bienveillance car pendant toute cette journée, sans s’inquiéter du montant des additions, des clients prolongèrent le mouvement, payant systématiquement les repas d’une autre table, sans prévenir, sans message, juste pour réserver une agréable surprise à des inconnus. Cela renvoie à la règle de la réciprocité dont nous parle le sociologue Alvin Gouldner : l’humain qui reçoit quelque chose de positif d’un autre humain a tendance à rendre la pareille. C’est un code moral universel très puissant.
Un terme de psychologie positive revient beaucoup dans vos écrits, celui d’« élévation ». Que recouvre-t-il ?
Il résulte des travaux de recherche du psychologue américain Jonathan Haidt. Ceux-ci montrent que les biographies de personnages réels ou de fiction qui incarnent la bonté, que ce soit dans des livres ou dans des films, nous inspirent, nous élèvent en nous donnant envie d’être plus humain. Les histoires positives ont donc aussi un effet de pollinisation. J’en ai la conviction : souligner plus ce qui est positif chez l’humain, réhabiliter la bonté, révéler sa présence manifeste dans ce monde peut conduire à une humanité meilleure. Encore une fois, ne me prenez pas pour un naïf. Je vois les guerres, les injustices, la planète en danger à cause des comportements destructeurs de notre espèce. Cela incite à un certain pessimisme, au désabusement, à la désespérance. Mais, en même temps, le réalisme ne doit pas tuer tout optimisme. Aussi, je crois à ce que les physiciens appellent les points de bascule : ces moments où un système change brutalement. Il y a un chemin que la science nous montre dès lors qu’elle a établi que nous sommes biologiquement prédisposés à la bonté. Que nous ne sommes pas fondamentalement, par nature, des êtres égoïstes et violents. Alors, évidemment, je ne suis pas devin. Mettra-t-on un jour la bonté et la coopération au centre des politiques publiques ? Nous dirigeons-nous plutôt vers un monde toujours plus compétitif, qui finira par devenir vraiment « orwellien », ou — si cela parle plus aux jeunes générations — qui finira par ressembler à celui des « Hunger Games » ? Ces enjeux questionnent à la fois notre responsabilité collective et notre responsabilité individuelle dans la mesure où tous, dans notre quotidien, nous pouvons être des pollinisateurs de bonté.